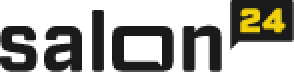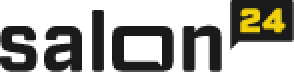Adam FULARZ, 2002
Renault en France en 1990, puis la British Aerospace au Royaume- Uni en ce début d’année 1993, sont bénéficiaires d’aides nationales. Ils ont spectaculairement attiré l’attention sur la récupération des aides versées en violation du droit communautaire.
Aux termes de l’article 92 du traité de Rome, les aides d’Etat, sous queque forme que ce soit, sont incompatibiles avec le marché commun, dès lors qu’elles affectent les échanges entre Etats membres, faussent ou menacent de fausser la concurrence et favorisent certaines entreprises ou production.
Il appartient à la Comission d’y veiller en tant que gardienne du traité et en application de son pouvoir de contrôle et de sanction des aides de l’Etat (article 93).L’intervention de la Colission a été de plus en plus systématique, lorsque la perspective d’un grand marché concurrentiel a inspiré sa démarche. C’est en effet une politique radicale de récupération des aides. L’offensive de la Comission contre l’indiscipline des Etats et de leurs collectivités est neanmis ccanalisé et obéit à des règles très strictes définies par la Cour. La Commission doit motiver son intervention, respecter les droits de la défense, agi à des procédures etablies par le traité. La création et le maintien d’un système de concurrence libre et non fausée est l’un des principes fondamentaux sur lequel la Communauté économique européenne a été bâtie. En effet, les Etats membres auraient-ils renoncé à l’application d’instruments protectionistes à leurs échanges mutuels, s’ils n’avzaient eu, en contrepartie, la garantie d’une concurrence sufisamment loyale ?
A l’evidence, la libéralisation progressive des échanges devait impérativement s’accompagner d’une politique de concurrence efficace.
Le traité de Rome de 1957 affirme résolument son attachement au système de l’économie de marché. D’une inspiration souvent qualifiée de « neo-liberale », lion de modèle du « laisser-faire », il tend à sauvegarder une concurrence effective entre les opérateurs économiques de la Communauté.
Ainsi, dès le préambule, il est possible de remarquer une prèmière référence à la concurrence : « Reconnaissant que l’elimination des obstacles existants appelle une action concertee en vue de garantir la stabilité dans l’expansion, l’équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence ».
Plus précisement, l’article 3 du traité énonce que « ..l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :
f)l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché commun.
Ainsi ? dès la création de la CEE, les gouvernements nationaux ont accepté de renoncer à leur autonomie en ce qui concerne l’octroi d’aides à leurs entreprises, et de se soumettre, sur ce point, à un contrôle communautaire. Ils ont admis l’idée de l’incompatibilité de principe des aides avec le droit communautaire et celle de dérogations prévues par le traité, al Commission u le Conseil.
L’interventionnnisme économiqsue ne disparaît pas, l’aide d’Etat reste d’ailleurs un instrument privilégié de politique économique : c’est sa liberté qui est remise en cause.
L’etat et, plus généralement, les collectivités publiques, peuvent agir directement sur la production et la commercialisation de biens ou de services. Ils opèrent sur le marché en qualité de producteurs, généralement par l’intermédiaire d’entreprises publiques.
Les collectivités publiques interviennent également sur le marché en tant qu’acheteurs. Les collectivités publiques interviennent dans l’économie, de façon moins directe, par l’octroi d’aides à leurs entreprises. Entre 1986 et 1998, les aides nationales représentaient en moyenne 82.3 milliards d’écus par en, soit 2.2 % du PIB communautaire, 4.5% des dépenses totales des administrations publiques et plus du double du budget communautaire.
D’un point de vue macro-économique, les aides d’Etat sont signifivcatives dans tous les Etats membres , même si leur ampleur varie considéra&blement d’un Etat à l’autre : ainsi le Danemark et le Royaume-Uni consacrent à peine 1 % de leur PIB aux aides, tandis que la Belgique, la Grèce, l’Italie et le Luxembourg ne leur en consacrent pas moins de 3 %. La France se situe dans la moyenne de 2 %.
L’étude de la ventilation sectorielle des aides révèle les résultats suivants : le secteur manufacturier reçoit 41 % des aides, le secteur des chemins de fer 30 %, l’industrie houillère 16 % et l’agriculture 13 %.
18 mars 2002
Absolwent Universite de Metz i Viadrina University, ekonomista. Specjalizuje się w infrastrukturze. Zawodowo jednak zajmuje się branżą e-commerce, ostatnio tworząc np. portal poselska.pl czy ie.org.pl. Interesuje się historią i muzyką. Uprawia sporty: capoeirę, downhill i snowboard. Interesuje się też ochroną zabytków i środowiska naturalnego. Poglądy gospodarcze: ordoliberał, wyznanie: Rastafari/Baha'i. Email: phooli(małpa)gmail.com
Czasopismo Gazeta Poselska
Promote your Page too
Nowości od blogera
Inne tematy w dziale Polityka